Par James Martin, avec des dossiers de Patrick McDonagh
Les étudiants de premier cycle de McGill : du laboratoire au terrain et de la théorie à la pratique

En août 2006, des fouilles dirigées par André Costopoulos ont permis de découvrir une imposante structure en pierre près de Wemindji, un village cri éloigné de la côte est de la baie James. Puisant aux sources de sa connaissance approfondie de l’archéologie nord-européenne, le Pr Costopoulos était persuadé qu’il avait découvert les vestiges d’une ancienne demeure… mais il se trouve que ses collèges n’étaient pas d’accord avec lui.
« Une véritable rébellion couvait dans les rangs! », plaisante le professeur d’anthropologie de McGill. Ce qu’il pensait être les murs extérieurs d’un imposant édifice était, pour ses collègues, les ruines d’un âtre qui avait dû se situer au centre d’un édifice encore plus imposant. Tout discours universitaire qui se respecte est forcément source de fréquents désaccords, mais dans le cas qui nous intéresse, la dissension avait la particularité d’être exprimée par des étudiants de premier cycle.
Ces jeunes sceptiques sont les illustres représentants d’une nouvelle expérience menée par McGill qui encourage les étudiants de premier cycle à appliquer la théorie à la pratique, dans le cadre de laboratoires, de cliniques, de fouilles ou d’archives. En 2005, la Faculté des sciences de McGill a officialisé cet engagement en créant le Bureau de la recherche scientifique de premier cycle. Premier du genre au Canada, ce bureau coordonne les différentes activités de recherche des étudiants de premier cycle, de même que les cours de recherche facultatifs et une conférence annuelle consacrée aux recherches menées par les étudiants. D’autres facultés prévoient suivre cet exemple et certaines, dont celle de médecine dentaire, se font déjà un point d’honneur de communiquer avec chaque étudiant de premier cycle admissible pour d’éventuelles recherches. Les professeurs recrutent également des étudiants dans leurs cours et par le biais d’annonces sur Internet. Au cours de l’année universitaire 2006-2007, McGill comptait près de 2 000 chercheurs de premier cycle et il ne fait aucun doute que ce chiffre augmentera lorsque les étudiants auront pris la pleine mesure de l’intérêt de la recherche.
Les étudiants manifestent incontestablement une volonté certaine de mettre la main à la pâte, au propre comme au figuré. « La recherche ouvre des horizons dont les cours magistraux sont dépourvus, car ils sont très théoriques », explique Colin Nielsen, un étudiant en archéologie âgé de 24 ans qui a participé aux fouilles de Wemindji. « Déterrer de mes propres mains d’anciens grattoirs en pierre à la baie James est beaucoup plus satisfaisant que lire un compte rendu de fouilles. »
Mais la recherche n’est pas seulement un agréable changement de décor. « Le rôle de l’université ne se borne pas à l’enseignement de faits ou de techniques », souligne Jay Nadeau, professeure au Département de génie biomédical, qui a commencé à travailler avec des chercheurs de premier cycle l’an dernier. « Elle doit également apprendre aux étudiants qu’ils peuvent se pencher sur n’importe quel problème, sous réserve qu’ils possèdent les connaissances et les outils pour y parvenir. Il n’y a rien de plus merveilleux que d’observer les étudiants apprendre à mobiliser les élé- ments (qu’il s’agisse d’outils ou de connaissances) pour répondre à une question. Ils apprennent véritablement à réfléchir et à analyser. »

En 2006, Jay Nadeau a recruté 12 étudiants pour participer au Concours annuel international sur les machines génétiquement modifiées (iGEM) qu’organise l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT). Chaque année, des équipes de plus de 12 pays ont pour mission de concevoir et d’assembler des machines génétiquement modifiées à l’aide du même ensemble d’éléments génétiques (essentiellement pour l’expression chez les bactéries) et les mêmes techniques de clonage moléculaire. « Nous découvrons comment sont élaborés les projets de recherche », explique Jamie Schafer, 20 ans, étudiante de 2e année en microbiologie et immunologie. Son équipe iGEM a synchronisé l’oscillation d’une protéine fluorescente dans un groupe de cellules, ce qui revient en quelque sorte à créer un jeu de petites biolumières clignotantes. « L’éventail de projets élaborés dans le cadre du Concours iGEM, tous issus des mêmes matériaux de départ, m’a fait prendre conscience de l’immense potentiel de la recherche. »
Pour Jamie Schafer, la recherche de premier cycle fait plus que conforter son intérêt pour les études supérieures. Chez certains étudiants, l’expérience de la recherche ouvre des horizons professionnels auxquels ils n’avaient jamais songé. Au cours de sa dernière année d’études de premier cycle en psychologie, Anne Hand, 22 ans, a travaillé avec Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur le stress humain à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, pour déterminer comment la lecture d’ouvrages pratiques agissait sur le niveau de stress d’Anglophones montréalais en santé âgés de 18 à 65 ans. « La recherche m’a fait comprendre que pour mener des travaux d’envergure internationale et transculturels dans le secteur de la santé, il fallait absolument parler au moins deux langues », souligne-t-elle. Elle prévoit d’ailleurs perfectionner ses con- naissances de l’espagnol en participant à un programme d’immersion l’an prochain. «J’ai également pris conscience que je préférais travailler auprès de populations cliniques ou à l’élaboration de politiques, car j’ai pu constater à quel point les politiques influençaient directement les efforts des chercheurs à la base, en bien comme en mal. » Cet été, elle fera une présentation par affiches sur ses recherches à l’occasion de la conférence de la Société internationale de psychoneuroendocrinologie, qui aura lieu dans le Wisconsin, et du Colloque Hans Selye sur le stress à Montréal.
Également étudiante en psychologie, Laura Cooper présentera pour sa part le fruit de ses travaux de recherche lors de deux conférences. L’automne dernier, l’étudiante âgée de 22 ans a conçu un programme intitulé « De-Stress for Success », qui fait appel à des ateliers interactifs pour apprendre aux nouveaux étudiants montréalais de niveau secondaire à gérer leur stress. Cet été, lorsqu’elle présentera les données issues de ses travaux, Laura Cooper aura satisfait aux exigences de son B.A., mais son programme de recherche se poursuivra longtemps après l’obtention de son diplôme : une étude pilote est en effet prévue dans les écoles de Montréal en septembre. « J’envisage de faire des études supérieures », dit-elle, « mais pas dans l’immédiat. J’aimerais trouver un emploi qui me permette d’appliquer mes compétences en matière de recherche », précise-t-elle. Elle envisage une carrière dans la coordination et l’évaluation de programmes sociaux d’ONG, « mais je pense que la recherche continuera de faire partie de la profession ou des études que je choisirai à terme. »
« La recherche de premier cycle donne aux étudiants la possibilité de se familiariser sans risque avec les études supérieures », souligne la Pre Nadeau. « Le pire qui puisse arriver est de faire des études supérieures pendant cinq ou six ans, sans parvenir à publier le moindre article. Fort heureusement, les recherches de premier cycle procurent essentiellement des satisfactions. Et si les étudiants finissent par publier, c’est en quelque sorte une gratification additionnelle. »
Et tout porte à croire que les étudiants de premier cycle de McGill apprécient cette gratification : plusieurs d’entre eux ont eu un avant-goût de la publication dans des revues à comité de lecture, que ce soit à l’échelle de l’Université (comme dans le cadre de la nouvelle publication McGill Science Undergraduate Research Journal) ou dans les publications internationales. En 2004, l’étudiante de médecine dentaire Romina Perri, aujourd’hui âgée de 23 ans, participait à une étude clinique de la Pre Jocelyne Feine relativement à l’impact des implants dentaires sur la santé. Malgré la satisfaction qu’elle en a tirée, elle souhaitait prendre part à un projet plus personnel.

La Pre Feine lui a alors proposé d’analyser les stratégies permettant de recruter 250 participants ou plus dans le cadre d’une étude. Résultat : Romina Perri est l’auteure principale de l’article « Monitoring Recruitment Success and Cost in a Randomized Clinical Trial », publié dans l’European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry. Cet article, que Romina Perri a présenté à la conférence de l’Association internationale de recherche dentaire à Baltimore, est susceptible de faire le bonheur de chercheurs en quête de méthodes rentables de recrutement qui respectent leurs contraintes budgétaires. « Ce projet m’a permis de me faire une idée plus large de la médecine dentaire et de voir qu’elle recelait d’immenses possibilités », souligne Romina Perri, qui étudie les troubles de l’articulation temporomandibulaire avec James Lund, doyen de la Faculté de médecine dentaire. En 2008, une fois son diplôme obtenu, Romina espère poursuivre des études supérieures en périodontie.
Questionnés au sujet des qualités d’un bon chercheur-étudiant, les professeurs sont unanimes : imagination, ouverture d’esprit, créativité, souplesse, motivation, audace, témérité. « Ils ont le courage d’explorer de nouvelles pistes, sans crainte de casser ou de gâcher quoi que ce soit », souligne la Pre Nadeau. « Faire de la recherche, c’est aussi prendre conscience que même les “mauvaises données” peuvent parfois être utiles. »
La recherche est aussi une affaire de ténacité. « Ces étudiants ne se laissent pas intimider par le fait que personne avant eux ne soit parvenu à répondre aux questions qu’ils se posent », souligne le pr Costopoulos. Il en veut pour preuve l’exemple d’une de ses étudiantes de premier cycle : dans le cadre de ses recherches sur la faïence du XVIIIe siècle, Theresa Gabos a découvert des fragments de terre cuite française en participant à des fouilles archéologiques au Musée de Pointe-à-Callière, lieu des premiers peuplements de Montréal. L’étudiante de 23 ans souhaitait savoir ce que ces fragments pouvaient lui apprendre sur les réseaux d’échange qui existaient à cette époque au Québec, mais la typologie de la céramique, largement fondée sur le décor ou la conception, s’est malheureusement révélée fort peu utile pour l’identification de petits fragments. Loin de s’avouer vaincue, Theresa Gabos a alors créé une nouvelle typologie en fonction de la porosité et de la composition de la pâte de céramique.
« Je voulais catégoriser les céramiques d’une manière moins subjective que celle proposée par les méthodes en vigueur », souligne-t-elle. « Il s’agissait d’un réel défi. J’ai ainsi découvert que l’archéologie est un immense casse-tête dont on ne connaît pas le nombre de pièces et dont beaucoup sont manquantes. »
« Je passe le plus clair de mon temps à rassurer les étudiants sur la justesse de leur intuition », ajoute son superviseur. « Et lorsqu’ils sont dans l’impasse, je leur explique pourquoi. Les joies de la recherche sont faciles. Mon rôle est d’être présent lorsque surgissent les frustrations. »
Et les frustrations peuvent être légion. « Il est important que les étudiants apprennent à ne pas avoir peur de l’échec », souligne Nilima Nigam, professeure au Département de mathématiques et statistique. « Il faut absolument se familiariser avec l’échec et ne pas se décourager lorsque la première hypothèse retenue fait chou blanc. C’est là qu’intervient la créativité : si la première ou deuxième stratégie ne donne rien, il faut ramasser les morceaux et essayer autre chose. »
La Pre Nigam a observé Tayeb Aïssiou, un étudiant de 21 ans en dernière année de physique mathématique, vivre exactement cette expérience. En 2005, Tayeb Aïssiou a pris contact avec la Pre Nigam dans le but de participer à des travaux de recherche. Elle l’a alors invité à intégrer le projet qu’elle menait en collaboration avec la Pre Svetlana Komarova de la Faculté de médecine dentaire, lequel consistait à modéliser la dynamique des populations au sein des cellules ostéoclastes intervenant dans la croissance osseuse. Tayeb Aïssiou devait construire un modèle mathématique pour prédire les fluctuations dans les populations de cellules. « Je voulais faire quelque chose de différent », explique Tayeb, qui n’avait aucune connaissance particulière en biologie en dehors de ce qu’il avait appris au cégep, « et je pensais que la recherche en biologie serait intéressante. » Il s’est alors attaché à combler ses lacunes en s’imposant un strict régime d’études et en apprenant à élaborer, mener et interpréter des essais biologiques en laboratoire. « Ses premières expériences n’étaient pas franchement réussies », se souvient la Pre Nigam. « Et même lorsqu’il les réussissait, ses premiers modèles mathématiques n’apportaient aucune explication. Cent fois Tayeb a remis son ouvrage sur le métier, jusqu’à ce qu’il puisse prédire avec succès un phénomène qu’il a ensuite observé dans ses travaux. » Le fruit de la ténacité de Tayeb lui a ouvert de nouveaux horizons de recherche et il est actuellement coauteur d’un article qui repose sur les travaux qu’il a menés.
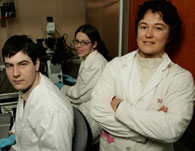
La Pre Nigam se félicite des changements qu’elle a pu observer chez cet étudiant remarquable. « Tayeb est devenu plus téméraire », précise-t-elle. « Il est davantage ouvert à de nouvelles idées et accepte désormais que tous les aspects des sciences de la vie n’aient pas nécessairement une solution mathématique idéale et élégante. Il a découvert l’investigation ouverte et s’est forgé un véritable tempérament de chercheur. »
Si la recherche peut changer les étudiants, l’inverse est également possible. Lorsque l’équipe de Jay Nadeau n’arrivait pas à sélectionner des colonies de bactéries pour exprimer une protéine fluorescente jaune, l’étudiant de biochimie et participant au Concours iGEM Adam Katolik s’est plongé dans une recherche bibliographique exhaustive. L’étudiant de 22 ans a ainsi déniché une méthode de réaction en chaîne de la polymérase tellement méconnue que même la Pre Nadeau n’en avait jamais entendu parler et il se trouve que celle-ci a fonctionné à merveille. « Je n’ai jamais rencontré quelqu’un aussi dévoué qu’Adam », souligne la Pre Nadeau. « Il excelle dans la recherche exhaustive et c’est une qualité importante que beaucoup d’étudiants de 2e/3e cycles ne possèdent pas. »
André Costopoulos se souvient pour sa part de l’époque où Colin Nielsen et lui utilisaient trois logiciels différents pour aider un étudiant à reconstruire les « champs de vision » (zones visibles à partir d’un point du vue fixe) des forts de l’âge du fer dans le sud de l’Espagne. Colin Nielsen avait remarqué que chaque programme produisait des résultats légèrement différents. Il a alors soumis les divers logiciels à une batterie de tests de sa propre invention et découvert un lien systématique entre les variables de terrain et les logiciels.
« Seule la perspective d’ensemble me préoccupait », admet le Pr Costopoulos. « J’étais prêt à accepter que l’existence de ces différents champs de vision résultait d’une erreur expérimentale avec à charge, le devoir de quantifier l’erreur. Mais Colin a grandi avec les ordinateurs et pour lui, il fallait impérativement chercher à comprendre pourquoi différents logiciels produisaient des résultats aussi divergents. Sa curiosité a non seulement permis de corriger les résultats antérieurs, mais elle permettra aussi d’obtenir des résultats beaucoup plus précis à l’avenir. »

« Les étudiants de premier cycle posent des questions et proposent des idées auxquelles nous n’avions jamais songé, ce qui donne naissance à de nouvelles hypothèses », ajoute-t-il. « Lorsque je vois une forme surgir des fouilles, j’ai déjà une idée préconçue de ce que je pense avoir trouvé. Les étudiants jettent un éclairage nouveau sur des problèmes anciens, ce qui peut déboucher sur des points de vue surprenants et utiles à l’avancement des connaissances. »
Et cela nous ramène tout naturellement à Wemindji. En août, André Costopoulos et ses étudiants de premier cycle retourneront à la baie James. Âtre ou construction? La question doit être tranchée.
« Si les étudiants n’avaient pas été là l’an dernier », souligne le professeur, « il n’y aurait pas de débat – pour moi, c’était une évidence, si bien que je me serais concentré sur d’autres questions. Mais les étudiants m’ont mis sur la brèche en mettant en doute mes conclusions. Pour les fouilles de cette année, nous allons réorienter nos efforts en tenant compte de leurs remarques. »
L’équipe a bien hâte de résoudre le mystère, d’appliquer la théorie à la pratique et d’apporter une contribution utile aux connaissances sur la vie dans le Nord québécois il y a 4 000 ans.
« Sans compter », ajoute André Costopoulos, « qu’il y a une réelle victoire à décrocher et toute la légitimité voulue pour s’en vanter!
