Une analyse révolutionnaire de l’ADN révèle que le diabète de type 2 est beaucoup plus complexe qu’on ne le croyait, pour le plus grand bonheur des chercheurs.
By Mark Reynolds
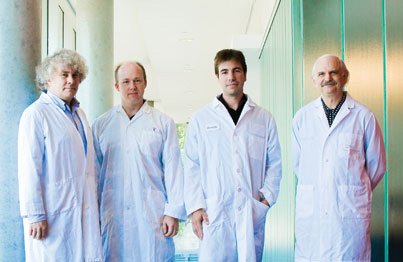
D’ici 2010, près de 3 millions de Canadiens recevront un diagnostic de diabète de type 2. Contrairement au diabète de type 1, une maladie auto-immune incurable, le diabète de type 2 (diabète de l’adulte) est un trouble métabolique qu’il est souvent possible de contrôler ou de prévenir en surveillant son alimentation et en pratiquant une activité physique. Mais lorsqu’il n’est pas convenablement traité, le diabète de type 2 peut coûter très cher et faire peser sur les personnes qui en sont atteintes un risque élevé de cécité, d’insuffisance cardiaque et hépatique et de différentes maladies.
Compte tenu des enjeux, le Dr Rob Sladek et ses cochercheurs de McGill, du Collège impérial de Londres, du Centre national de la recherche scientifique, situé à Lille, en France, et de l’Université de Montréal, pouvaient à juste titre être fiers d’avoir identifié l’an dernier quatre nouveaux gènes associés à cette maladie. Que leur article publié dans Nature soit le cinquième article scientifique le plus cité de 2007, selon le site de classement et d’analyse de publications scientifiques ScienceWatch.com, n’est en fait que la cerise sur le gâteau (sans sucre, bien sûr). Mais sans le facteur chance ni la souplesse, cette découverte aurait très bien pu ne jamais se matérialiser.
Rob Sladek, professeur adjoint au Département de génétique humaine et d’endocrinologie, explique que le projet initial de son équipe était d’identifier les gènes candidats à l’aide de modèles animaux. Ce plan prévoyait d’induire le diabète chez les rongeurs, puis d’identifier les gènes qui semblaient activés ou altérés par la présence de la maladie.
« Si nous avions suivi cette piste, nous aurions probablement trouvé un ou deux gènes, et sans doute des gènes déjà connus », souligne-t-il.
Alors qu’il planifiait ces expériences, « la technologie [les] a devancés », avec la multiplication des microréseaux. Grâce à ces dispositifs, il est devenu possible de balayer rapidement l’intégralité du code génétique humain, si bien que l’équipe a rapidement modifié ses plans au profit d’études d’association à l’échelle du génome entier. Les études d’association pangénomique font appel au balayage génomique de plusieurs centaines de sujets, et permettent d’utiliser les statistiques pour identifier les gènes associés à certaines caractéristiques.
Le temps pressait. Les chercheurs principaux – le Dr Philippe Froguel, David Meyre et Christian Dina du Collège impérial de Londres, le Dr Barry Posner de McGill et Marc Prentki de l’Université de Montréal – savaient qu’ils rivalisaient avec un certain nombre de poids lourds dans la course à la publication, au nombre desquels figuraient l’Institut Broad de Harvard, le Wellcome Trust d’Angleterre et les Instituts nationaux de santé, situés à Washington.
Fort heureusement, le Dr Sladek et ses collègues ont eu accès aux techniques de pointe et à l’expertise du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill (CIGQUM), sans parler des quelque 3 000 échantillons d’ADN de sujets diabétiques, laborieusement recueillis et catalogués par l’équipe de recherche française de l’étude DESIR (Données épidémiologiques sur le syndrome d’insulinorésistance) et des chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille. Johan Rung, un bioinformaticien du CIGQUM, Alexandre Montpetit, directeur scientifique adjoint du centre, et le boursier postdoctoral Ghislain Rocheleau ont supervisé l’analyse statistique de la quantité astronomique de données recueillies, et M. Rocheleau est devenu le principal auteur de l’article publié dans Nature.
Auteur-ressource, le Dr Constantin Polychronakos explique que la rapidité et la fiabilité des résultats obtenus sont attribuables à la quantité d’échantillons et de données que l’équipe avait en sa possession sur les donneurs (poids, âge d’apparition du diabète et antécédents médicaux).
« Nous savions que l’obésité était un facteur, mais nous souhaitions découvrir les autres facteurs en jeu, si bien que nous avons axé nos recherches sur les diabétiques minces », précise le professeur de pédiatrie et de génétique humaine. L’équipe mcgilloise a ainsi pu obtenir une meilleure corrélation, ou « ordre d’amplitude » pour reprendre les termes du Dr Polychronakos, que celle trouvée ultérieurement par les études concurrentes.
Les milliers d’échantillons ont été envoyés à Montréal où ils ont été passés dans les microréseaux du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill, situé sur le campus du centre-ville de McGill. L’équipe a ensuite pu localiser les quatre gènes et au moins « une adresse ou un numéro d’appartement pour chacun d’eux », souligne le Dr Sladek.
Deux des quatre gènes identifiés par l’équipe mcgilloise ont été confirmés par les données issues d’études menées ultérieurement par les équipes concurrentes, et sont les plus prometteurs pour les futures recherches. Les deux autres partagent le même « numéro d’appartement » génomique, ce qui complique la caractérisation de leur fonction. Le Dr Polychronakos admet que leur corrélation pourrait tout simplement être une aberration statistique.
Les deux gènes corroborés par les études ultérieures jouent un rôle important dans les cellules bêta pancréatiques. L’un d’eux, HHEX, est en fait un commutateur qui régule l’expression des protéines. La caractérisation précise de sa fonction devrait intervenir d’ici un ou deux ans, selon le Dr Sladek, qui pense toutefois qu’elle est liée au développement des tissus pancréatiques. L’autre gène, SLC30A8 (ou Znt8), n’est exprimé que par les cellules bêta pancréatiques et est utilisé dans le métabolisme du zinc, qui est à son tour utilisé dans la synthèse de l’insuline.
Bien qu’il soit possible que ces découvertes débouchent sur des traitements cliniques du diabète (en stimulant le transport du zinc, par exemple), elles illustrent surtout l’extrême complexité de la maladie. Il y a deux ans, les chercheurs savaient que trois gènes, voire un quatrième, étaient mis en cause dans le diabète. Aujourd’hui, ils pensent qu’il pourrait y en avoir cinquante. « Peu à peu, nous découvrons que les bases génétiques de la maladie diffèrent d’une personne à l’autre », explique Rob Sladek. « Même si nous pouvons expliquer beaucoup de choses, concevoir un test génétique fondé sur nos connaissances relève quand même du défi. Nous ne connaissons pas toutes les variantes possibles. L’intérêt de la recherche génétique tient à ce qu’elle pourrait nous donner pour la première fois les moyens de subdiviser le diabète de type 2 en différents groupes. Au cours des prochaines années, nous devrions commencer à percevoir les différences entre ces sous-groupes en termes d’évolution de la maladie, de la difficulté à la traiter et de l’effet de certains médicaments sur, par exemple, le diabète de type 2A, 2B ou 2C.
« Dans trente ans, il est possible que nous ne parlions plus de diabète de type 2, mais d’un large spectre de troubles différents. La porte que nous venons d’ouvrir débouche sur une multitude de pistes. »
Par conséquent, les recherches se poursuivent. Le Dr Sladek explique que son équipe fait déjà le suivi des résultats annoncés dans l’article paru dans Nature au moyen de cultures cellulaires et de modèles murins, dans l’espoir de mieux caractériser la nature des gènes HHEX et SLC30A8, et de trouver peut-être les moyens de corriger leurs fonctions.
Le Dr Polychronakos se réjouit de l’immense complexité que ces recherches ont permis de dévoiler. Les techniques à très large spectre utilisées pour identifier les gènes HHEX et SLC30A8 sont conçues pour trouver des variations communes. Selon lui, de nombreux cas de diabète se révéleront le résultat de mutations rares du code génétique.
Même si les Drs Sladek et Polychronakos ne pensaient pas figurer au tableau d’honneur de la science, ils sont à juste titre fiers de leur découverte.
« Nos travaux ont été récompensés – les citations sont un indice de l’impact que les recherches peuvent avoir. Elles sont la raison d’être de tout scientifique », souligne Constantin Polychronakos.
Cette étude a été financée par Génome Canada, Génome Québec et la Fondation canadienne pour l’innovation.
