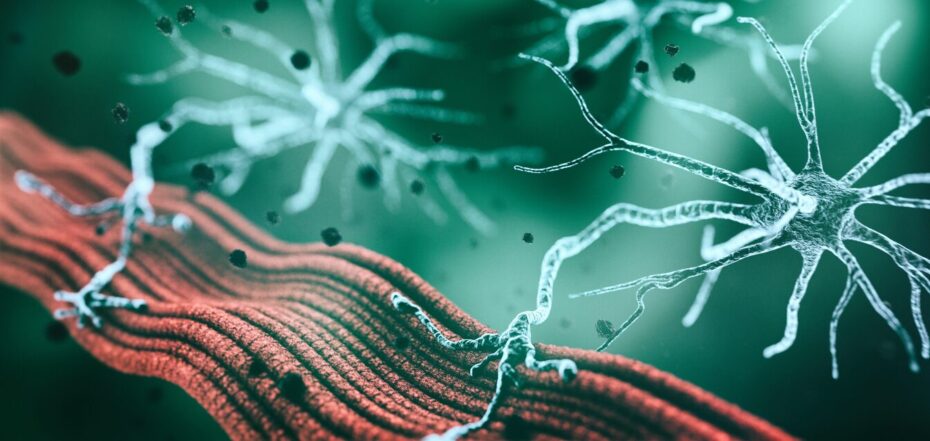
La moitié de la bataille dans le développement de traitements contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) est simplement de trouver la bonne cible. Plus de 80 % des cas de SLA sont considérés comme sporadiques, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de cause génétique connue, et donc aucune cible évidente vers laquelle orienter des traitements efficaces.
Les chercheurs savent que l’une des caractéristiques de la SLA est que la jonction neuromusculaire est endommagée, causant la perte de la connexion entre les cellules nerveuses et musculaires. Cela entraîne une faiblesse musculaire et éventuellement des difficultés à marcher, à accomplir les tâches quotidiennes, à avaler et à respirer.
Trouver un moyen de réparer cette jonction représenterait une étape majeure dans le traitement de la SLA. Un nouvel essai clinique au Neuro (Institut-Hôpital neurologique de Montréal) étudie un traitement approuvé pour l’hyperactivité vésicale qui pourrait également être efficace pour bloquer les cellules hyperactives qui provoquent la rupture de la connexion nerf-muscle dans la SLA.
Cellules hyperactives
Richard Robitaille, Ph.D., est professeur titulaire et chercheur en SLA à l’Université de Montréal. Son laboratoire se concentre sur le développement de stratégies pour réparer la jonction neuromusculaire. On sait que les dommages à cette jonction se produisent très tôt dans la maladie et constituent un facteur commun à tous les cas de SLA.
Selon la Société canadienne de la SLA, chaque année, environ 1 000 Canadiens meurent de la maladie. Un nombre similaire de Canadiens reçoivent un diagnostic annuellement. La plupart mourront dans les deux à cinq ans suivant le début de leurs symptômes en ayant perdu beaucoup de leurs capacités physiques et de leur qualité de vie. Un traitement efficace se fait attendre depuis longtemps.
« Ce qui différencie notre approche, c’est que nous avons considéré un type de cellule souvent négligé, mais qui est essentiel au maintien et à la réparation du contact nerf-muscle : la cellule gliale », explique professeur Robitaille. « Nous avons identifié un récepteur dans ces cellules – une sorte d’interrupteur principal – qui détermine si les cellules gliales répareront et soutiendront ou non la jonction neuromusculaire. Notre laboratoire a montré que ce mécanisme devient déréglé et hyperactif dans des modèles murins de la maladie. »
Traitement existant
Son équipe a examiné la littérature scientifique et a trouvé un médicament existant, la darifénacine, qui bloque les récepteurs qui contrôlent ce mécanisme et qui est approuvé par la FDA pour le traitement de l’hyperactivité vésicale. « Si nous réussissons à réduire cette hyperactivité, cela permettra aux cellules de faire correctement leur travail », poursuit-il.
Les travaux de son laboratoire sur des modèles murins ont montré que le médicament était capable de restaurer la fonction des récepteurs des cellules gliales. « Nous avons vu que le contact était maintenu entre le motoneurone et le muscle. Cela conduit à une meilleure fonction musculaire, une plus grande force et une meilleure capacité de marcher », a expliqué professeur Robitaille.
Partenariat montréalais
Les résultats des études précliniques ne se traduisent pas toujours chez les humains comme l’espèrent les chercheurs, c’est pourquoi la phase des essais cliniques est extrêmement importante. Grâce à une collaboration de longue date avec la directrice du Centre d’excellence sur la SLA au Neuro, Angela Genge, M.D., qui parraine l’essai à McGill, les travaux novateurs du professeur Robitaille seront testés à l’Unité de recherche clinique du Neuro (CRU) ainsi qu’à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa.
« C’est passionnant que nous collaborions et validions des recherches développées ici même à Montréal », explique Oliver Blanchard, M.D., neurologue et chercheur principal de l’essai au Neuro. « Ce type de partenariat entre chercheurs est essentiel pour accélérer les progrès en matière de traitement, en particulier dans le cas d’une maladie à évolution rapide comme la SLA. »
« Certains traitements ont réussi à prolonger la survie dans la SLA, mais la qualité de vie ne suit pas toujours. Le but ultime de notre approche est d’augmenter la force, la mobilité et la qualité de vie des patients – pour les aider à maintenir leur autonomie le plus longtemps possible », conclut Dr Blanchard. « En cas de succès, ce traitement s’appliquerait aux formes sporadiques et génétiques de SLA, ce qui est donc extrêmement prometteur. »
–
Les personnes vivant avec la SLA qui sont dans les trois ans suivant le diagnostic, qui présentent une faiblesse musculaire et une atrophie des membres supérieurs et inférieurs et qui peuvent avaler des comprimés sont recherchées pour l’étude. Pour plus d’informations, contactez als-cru.neuro@mcgill.ca ou appelez le (514) 398-5500.
